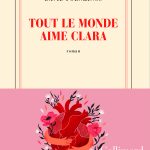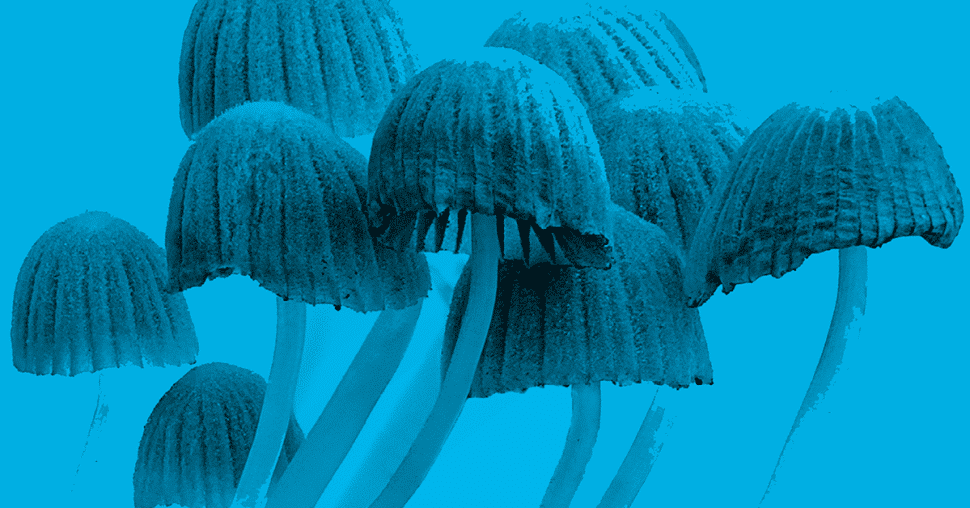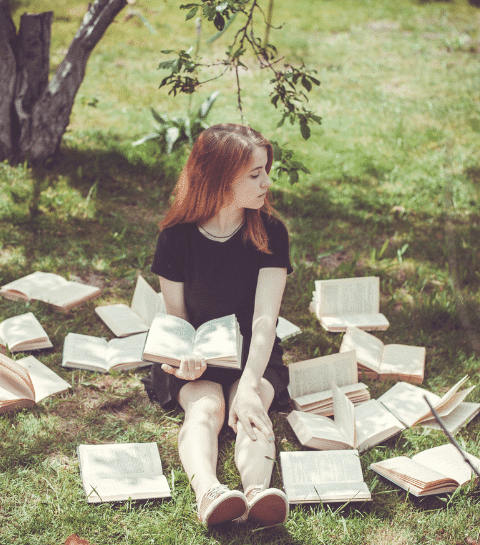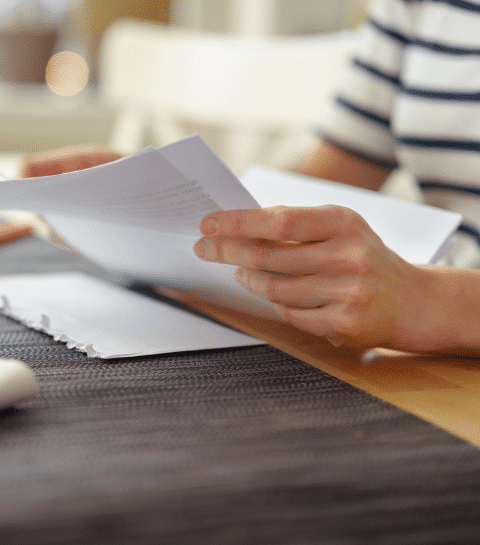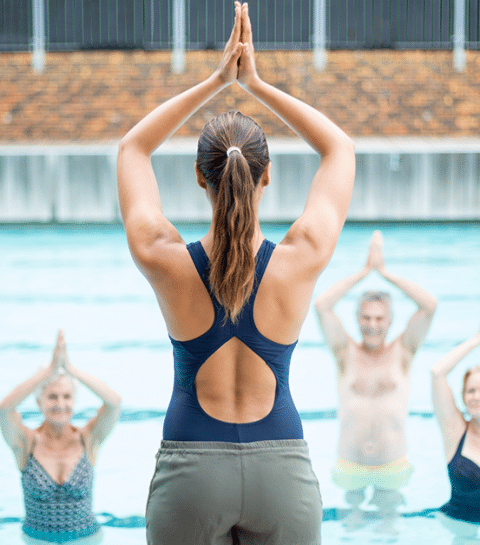Et s’il fallait se planter pour réussir ? Et si les portes fermées étaient la seule raison valable pour ouvrir la fenêtre, respirer, voir l’horizon plus large, plus beau, plus près ? Et si le sens de l’existence se trouvait dans ses lignes brisées ? Possible. En tout cas, quand on demande à David Foenkinos pourquoi il s’est mis à écrire, il répond : « Parce que je n’ai pas trouvé de bassiste. » La pirouette est jolie. Et la modestie peut avoir du panache quand elle dit vrai : ce groupe de musique, qui n’a jamais vu le jour, est celui qui lui laissera le temps d’envoyer ses premiers manuscrits… Tous recalés. Essaye encore. Page blanche. Recommence : Foenkinos mettra des années avant d’être publié. Pas grave. Tente ailleurs.
Ici, là, autrement, autre chose, mais quoi qu’il arrive, écrit. Cette fois, ça y est : en 2009, La Délicatesse, son huitième roman, se vend à plus d’un million d’exemplaires. « Ce livre a changé ma vie, se souvient-il. Très vite, on m’a proposé de travailler au tome II, mais ce qui m’intéresse, moi, c’est de ne jamais me reproduire. » Enchaîne avec Lennon, et imagine John sur le divan du psy. Essaye le théâtre. Pourquoi pas le cinéma ? Deux ans plus tard, David Foenkinos adapte… La Délicatesse avec son frère, Stéphane. Réalisateur, scénariste, dramaturge, romancier, peu importe, ce qui compte, c’est d’écrire. Inventer de nouvelles histoires. Se réinventer soi. Se promettre un monde parallèle, échapper au réel, pour mieux le raconter : vingt ans et près de vingt livres plus tard, David Foenkinos creuse son sillon, nourrit ses obsessions. Celle de la seconde chance. Celle de nos autres vies. Le public suit. Le public change. Depuis Charlotte, Goncourt des lycéens, et quelques incursions de l’écrivain sur les réseaux sociaux, il a même sacrément rajeuni : « C’est assez inexplicable pour moi, sourit-il, mais quand j’étais adolescent, les livres m’ont ouvert à la beauté, à la sensibilité, à la sensualité… Alors, rencontrer, en dédicaces, tous ces jeunes lecteurs me rend évidemment très heureux. » Clara aurait pu être parmi eux. Dernière héroïne échappée de son imaginaire, elle partage avec David Foenkinos le souvenir d’une jeunesse en ligne brisée. Et d’une fenêtre qui s’ouvre.
Son actu : Tout le monde aime Clara
Clara se réveille à l’hôpital après plusieurs mois de coma : le monde autour d’elle n’a pas bougé, c’est juste qu’elle le perçoit différemment. Son père, Alexis, est toujours le même, à part qu’il s’est enfin mis à écrire – un atelier d’écriture qu’il commence à fréquenter sans savoir réellement s’il en a envie. Éric Duprez, son professeur, lui, n’a plus jamais publié après un premier roman, désormais introuvable. Comme souvent, avec Foenkinos, c’est dans l’apparente banalité de nos vies que se niche l’extraordinaire : page après page, les trajectoires se rejoignent, le puzzle s’assemble, et ensemble, tout fait sens. Parce qu’ici, rien n’est jamais gratuit.
Tout le monde aime Clara de David Foenkinos (Gallimard, 208 p., 20 €).
Clara, votre héroïne, est fille unique. C’est un choix conscient de votre part ?
David Foenkinos : En fait, la plupart des enfants, dans mes romans, sont des enfants uniques. Et dans Deux Soeurs, l’issue est tragique, puisque l’une finit par tuer l’autre… C’est étonnant, quand on voit l’importance qu’a la fratrie pour moi [lire « Autofocus »]. Avec mon frère, on s’est stimulés, on s’est épaulés, on s’est apporté, parfois, ce qui a pu manquer à notre éducation – ma mère était employée chez Air France et mon père était commercial : on a voyagé beaucoup, mais il n’y avait pas de livres à la maison. Donc je sais la place, cruciale, que peuvent prendre ces liens-là. Simplement, Clara, je l’écris du point de vue d’Alexis, son père. Et moi, j’ai élevé pratiquement seul mon fils, puis ma fille, qui, eux, ont douze ans d’écart… Ce que j’ai connu, comme père, ce sont donc des tête-à-tête très fusionnels. Et j’adore ça !
Est-ce que, comme lui, vous avez toujours eu le désir de devenir père ?
D.F. : J’écris des fictions, mais j’y mets toujours beaucoup de moi. Et moi, j’ai vraiment été, très, très jeune, animé par le désir de devenir papa. Quand mon fils est arrivé, j’avais 28 ans, mais j’aurais pu l’avoir plus tôt. J’étais très attaché à mes grands-parents, à qui je posais beaucoup de questions, alors peut-être que j’avais le désir de transmettre à mon tour. Mais c’est peut-être lié, aussi, à cette infection de la plèvre que j’ai eue à 16 ans : quand tu rencontres la mort, tu vis toute la suite avec un sentiment d’urgence assez prégnant. Alors oui, peut-être que ce désir de paternité était un désir de vie. Pour ma fille, c’était tout aussi fort, voire impérieux : il fallait que j’aie un deuxième enfant avant 40 ans. Aujourd’hui, ma paternité tient une place essentielle dans ma vie, archi-dominante sur tout le reste. J’organise tout en fonction de ma fille, et je ne prends aucun rendez-vous après 16 heures. Une journée parfaite, c’est quand je l’amène à l’école et que je n’ai aucun autre rendez-vous jusqu’au soir.
Alexis, le père de Clara, est un grand solitaire. Vous aussi ?
D.F. : J’ai même un goût immodéré pour la solitude : je la recherche et elle m’obsède. Je ne réponds jamais au téléphone, je n’aime rien tant qu’avoir des heures entières pour lire, écrire, me promener… Seul. Mais j’ai la chance d’avoir une vie où je peux ne voir personne pendant deux mois – et ça, plutôt pendant les phases d’écriture – et puis éprouver l’immense plaisir de rencontrer des gens passionnants, de vivre des rencontres rares, intenses avec les lecteurs. Ça, c’est plutôt le temps de la promo, ou alors les plateaux de tournage – là, on frôle parfois l’hystérie collective, mais c’est très fort aussi. J’ai toujours un peu vécu comme ça, dans cette ambiance à deux têtes. C’est peut-être le slogan absolu de ma vie : ombre et lumière… Mais l’une nourrit l’autre : quand je suis en plein tournage, je rêve de retrouver mon lit et, dans mon lit, les gens me manquent. Je suis double Scorpion, c’est sans doute pour ça. Et c’est un peu épuisant. [Rires] En même temps, c’est un luxe, une vie à plusieurs vitesses, non ?
Dans sa vie, Alexis a toujours été un second choix. Vous, vous le ramenez au premier plan. Pourquoi ?
David Foenkinos : J’ai une tendresse infinie pour les figures de l’ombre. J’avais été frappé de voir combien Charlotte Salomon n’avait pas eu la place qu’elle méritait dans l’histoire de la peinture. J’ai sans doute eu envie, avec Charlotte, de la réhabiliter. Dans Numéro deux, j’imagine la vie de l’acteur qui a manqué de si peu le rôle de Harry Potter. La littérature est un temps long et, ce qui est très excitant pour le romancier que je suis, c’est de prendre un personnage dans l’ombre et de l’emmener progressivement vers la lumière. Alexis peut, dans un premier temps, ne pas paraître héroïque, au sens quasi littéral du terme. Mais au fil des pages, il le devient : il a tout le roman pour se comprendre et prendre le pouvoir sur lui-même.
C’est une trajectoire que vous avez connue, comme cadet de la fratrie ?
D.F. : Pas vraiment. Mon frère a six ans de plus que moi ; c’était un grand, il était assez peu présent. J’ai plutôt des souvenirs de solitude à la maison. Mes parents me laissaient tous les mercredis seul, sans rien avoir à faire de particulier – et c’est sans doute ce qui a développé mon imagination. Je n’avais pas confiance en moi. Terriblement complexé par ma maigreur, j’avais une insatisfaction physique totale. Est-ce que j’étais une figure de l’ombre ? Je ne sais pas. En tout cas, j’ai mis des décennies à placer un peu d’espoir en moi. Le lien social, en revanche, m’allait bien. J’étais bon élève et les gens me parlaient facilement. Je n’étais pas bagarreur, j’étais un doux et, donc, j’étais le meilleur ami des filles… Mais je ne leur plaisais pas. J’ai vécu ces moments un peu tragiques où elles viennent me raconter qu’elles sont amoureuses de Paul, qui, lui, fait du basket… Donc oui, en fait, j’ai tellement été un numéro deux.
Au début du roman, Alexis participe à un atelier d’écriture. Celui qui l’anime a arrêté d’écrire après un seul livre. Vous pourriez, vous, cesser d’écrire ?
D.F. : Il y a quelque chose de presque plus puissant à ne plus écrire. On touche au mythe de l’artiste maudit qui, chez nous, paraît toujours plus artiste que l’artiste épanoui. Mais arrêter, moi ? Impossible. J’ai essayé de faire des pauses, je n’y arrive pas. L’écriture m’envahit de façon obsessionnelle, quasi boulimique : plus j’avance et plus j’en ai besoin. J’ai beaucoup de mal avec le vide, et la créativité me remplit. Je crois que je pourrais devenir fou si je n’avais pas un projet en tête – fou ou désespéré. Moi, quand je me confronte à moimême et à l’écriture, ce n’est pas la page blanche qui m’effraie. C’est la médiocrité.
Vous faites, dans ce livre, le lien entre l’écriture et l’adultère. Écrire, c’est tromper ?
David Foenkinos : « J’écris, parce que je ne peux pas faire autrement », c’est la réponse la plus classique qu’on puisse faire, mais c’est vrai : l’écriture est mon sang et mon oxygène. Après, je crois que j’ai aussi ce besoin de vivre dans un roman, d’échapper à moi-même, de me quitter, sans doute pour mieux me retrouver. Mais je ne me rends compte qu’après coup de la part personnelle que je mets dans mes romans. Ça paraît fou, mais quand j’écris l’histoire d’une adolescente qui passe des mois à l’hôpital et en revient transfigurée, sur le moment, je ne fais pas du tout le lien avec moi. Je voulais, depuis longtemps, écrire sur la part ésotérique ou mystique des choses. Quand j’ai terminé l’écriture de Tout le monde aime Clara, j’ai compris qu’il y avait un lien, total, avec ce que j’avais vécu : côtoyer la mort et revenir à la vie de manière complètement différente. Je n’ai pas reçu le don de voyance après mon séjour à l’hôpital, mais subitement, des mondes parallèles s’étaient ouverts à moi.
Quels sont ces mondes parallèles ?
D.F. : J’ai basculé dans un rapport plus mystique aux choses de la vie. Cette infection de la plèvre était une maladie gravissime, mais rarissime à mon âge. On a mis beaucoup de temps à l’identifier et j’ai été opéré in extremis. Au moment où on me fait une prise de sang pour l’anesthésie générale, j’ai le coeur complètement compressé et je quitte mon corps. Ma mère dit qu’elle m’a vu mort. Moi, j’ai eu la sensation d’avancer dans un tunnel de lumière et de ressentir un profond soulagement. Et puis je me suis arrêté, j’ai fait le chemin inverse, je suis revenu à la vie : ça n’était pas mon heure. J’ai survécu, mais je suis resté des mois à l’hôpital. C’est là que j’ai commencé à lire, à souligner toutes les phrases qui me touchaient et, en fait, à percevoir la beauté, à m’en nourrir. Les livres m’ont consolé. Ils m’ont sauvé. Ceux de Patrick Modiano, par exemple, très importants pour moi quand j’étais adolescent. Il a cette phrase, très mystérieuse : « Ma mémoire précédait ma naissance. » J’aime cette idée qu’on porte en soi des vibrations du passé, et qu’on puisse sortir des cadres prédéfinis pour avoir une grille de lecture plus émotionnelle du monde. C’est aussi ce qui fait l’écrivain que je suis.
Que voulez-vous dire ?
D.F. : Certaines personnes ont déverrouillé leur sensibilité, développé leur empathie, au point d’avoir une compréhension quasi instantanée des autres, et peut-être même une intuition de l’avenir. Écrire, comme tout acte de création, suppose de libérer cette part non rationnelle, non raisonnable de soi. Moi, j’ai besoin de me laisser guider par des sensations que je ne maîtrise pas totalement. Je suis sensible aux signes de la vie, et ça n’est pas pour rien que j’ai un portrait de François Mitterrand dans mon salon : son « Je crois aux forces de l’esprit » m’avait beaucoup marqué et m’accompagne encore. Il y a des lieux qui nous parlent, il y a des gens qui nous habitent, il y a des récits qui nous appellent. La Délicatesse, j’ai l’impression de ne pas l’avoir écrit mais reçu. Je suis devant mon ordinateur et j’ai déjà tout en tête : les personnages, l’histoire, les lieux, tout m’est venu comme si je recevais des informations. Pour moi, c’est totalement improbable. Mais ça me pousse à l’humilité.
Autofocus : “Une harmonie absolue”

David et Stéphane Foenkinos
D.F. : On était à Cracovie, avec mon frère Stéphane, sur la route vers l’Ukraine, pour monter une pièce que j’avais écrite – une comédie sur l’amitié, dans un contexte aussi douloureux que la guerre, c’était quand même particulier. Comme souvent, c’est mon frère qui prend la photo. Il a une tendresse en lui qui lui donne envie de conserver ces moments où on est ensemble. En dehors du travail, ils sont assez rares. On est assez complémentaires et, sur un plateau de tournage, notre rapport est d’une harmonie absolue, d’une simplicité redoutable. La première fois, c’était pour La Délicatesse. C’est Stéphane qui m’avait convaincu d’adapter mon roman avec lui. Il a six ans de plus que moi, et il a souvent été moteur dans notre relation. J’ai découvert le cinéma, le théâtre, et tout ce qui a été important pour moi par la suite, grâce à lui. Mais lui dit qu’à partir de mon opération, c’est moi qui suis devenu l’aîné. Aujourd’hui, j’aimerais le retrouver sur un plateau. Est-ce que je vais réussir à le convaincre ? Pas sûr. Je crois qu’il n’a plus très envie de cinéma.
Texte : Giulia Foïs – Photos : Francesca Mantovani