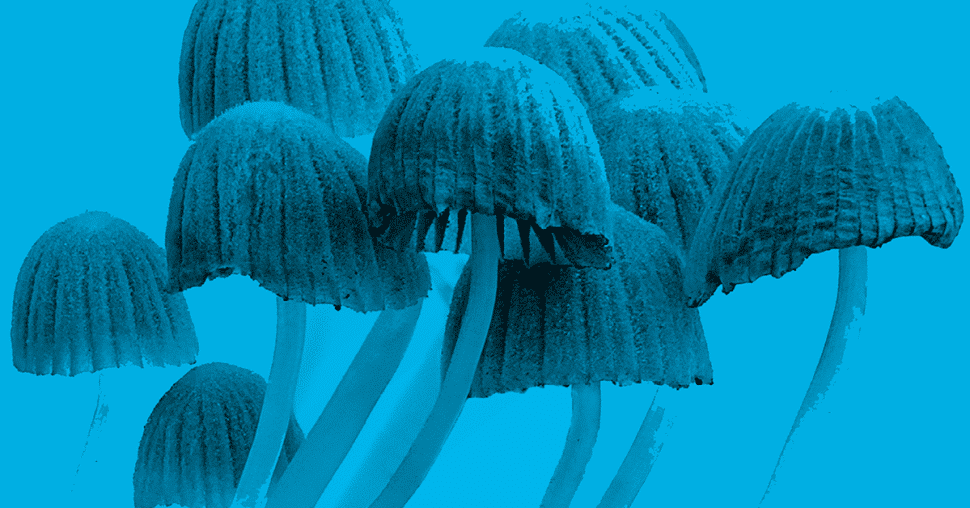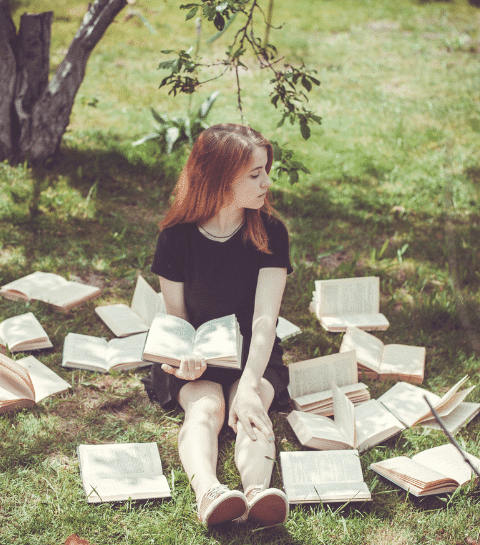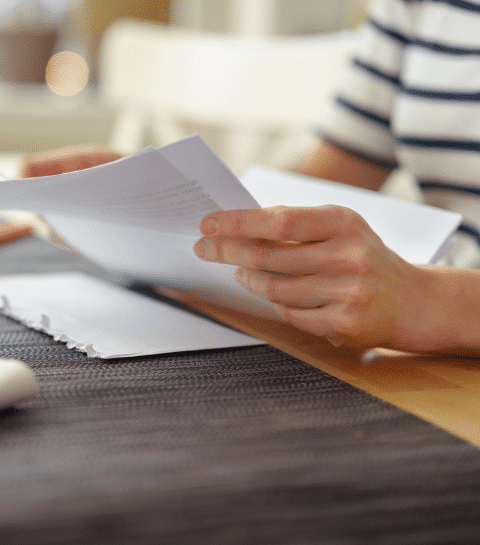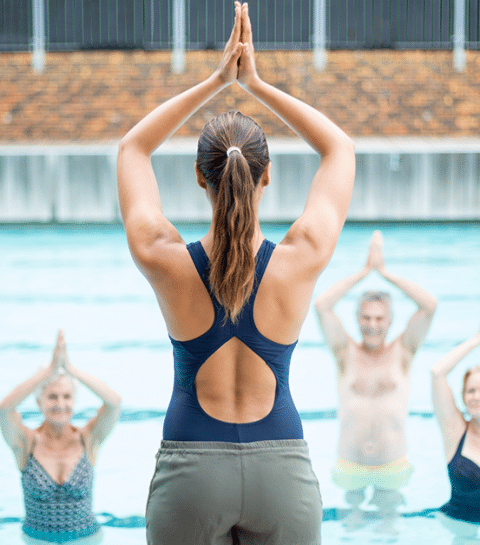Sur l’art et la manière de prendre une (bonne) décision, cessez de vous flagellez… Et dites-vous qu’il y aura toujours pire que vous ! La littérature nous offre volontiers – Dieu soit loué ! – un nombre incalculable de ratés… Laissez-moi, Augustin Trapenard, donc vous présenter le héros de roman le plus déculpabilisant. Faut-il d’ailleurs le qualifier de héros ? Il n’est ni beau, ni courageux, ni fort, ni vertueux. Chez lui, pas une once de panache, pas même un semblant d’audace. Seulement des rêves dont on se doute déjà qu’ils ne se réaliseront pas ! Si choisir, c’est renoncer, sachez que celui-là, sa seule décision consistera à ne jamais se mouiller, à se laisser porter par les événements et, donc, à échouer lamentablement tout au long du roman. Il s’appelle Moreau. Frédéric Moreau. Et sur les vingtsix années que couvre son Éducation sentimentale, il ne se passe rien, force est de le constater. Pas de carrière digne de ce nom, pas de coup d’éclat, pas même une histoire d’amour qui ne soit avortée.
Ce serait désespérant si Gustave Flaubert n’avait pas choisi d’en rire, plutôt que d’en pleurer. On l’entend à chaque phrase, ce rire assassin. Quand son jeune premier tombe amoureux d’une femme qui est bien sûr déjà mariée. Quand il galère à faire son droit et que personne n’en a rien à secouer. Quand il apprend qu’il est ruiné et qu’il doit tout abandonner, avant de revenir à Paris et de se refaire plumer. Rien n’y fait ! C’est le parcours le plus médiocre de toute l’histoire de la littérature. Tout au long du roman, il se trompe de combat et refuse surtout de faire le moindre choix. Ici et là, pourtant, le destin lui sourit ou lui tend une perche longue comme un bras : Frédéric l’ignore ou ne la voit même pas.
À chaque fois, pourtant, on espère. On se dit que c’est la bonne. Mais quand on devine, au bout du tunnel, une petite pointe de lumière, on se prend en pleine face le sadisme de Flaubert ! J’en veux pour preuve l’avant-dernier chapitre de L’Éducation sentimentale, quand, après des années de rendez- vous manqués, Frédéric retrouve celle qu’il a toujours aimée.
Voilà qu’ils se déclarent enfin l’un à l’autre. On se dit : vingt-six ans ! Ils en auront mis, du temps ! On espère, sans trop y croire, qu’ils vont enfin se rapprocher. Que peut-être un jour cet amour sera consommé. Il n’en est rien – vous vous en serez douté. Comble du pathétique, au moment de lui dire au revoir, elle lui tend une longue mèche de ses cheveux blancs. « Et ce fut tout », écrit l’auteur. Autant dire que ce ne fut rien du tout. Voilà ce qui attend ceux qui ne font pas de choix, qui ne courent aucun risque et qui n’ont ni la chance, ni l’élégance de s’être un jour trompés. Ce que décrit Gustave Flaubert, non sans délice et cruauté, c’est la vacuité de son époque. Celle, en particulier, d’une certaine jeunesse qui passe à côté de l’histoire. Qui la regarde sans y prendre part. Une jeunesse passive, indécise, bêtement romantique. Une jeunesse – à mon avis – aux antipodes de celle d’aujourd’hui.
Texte : Augustin Trapenard