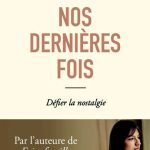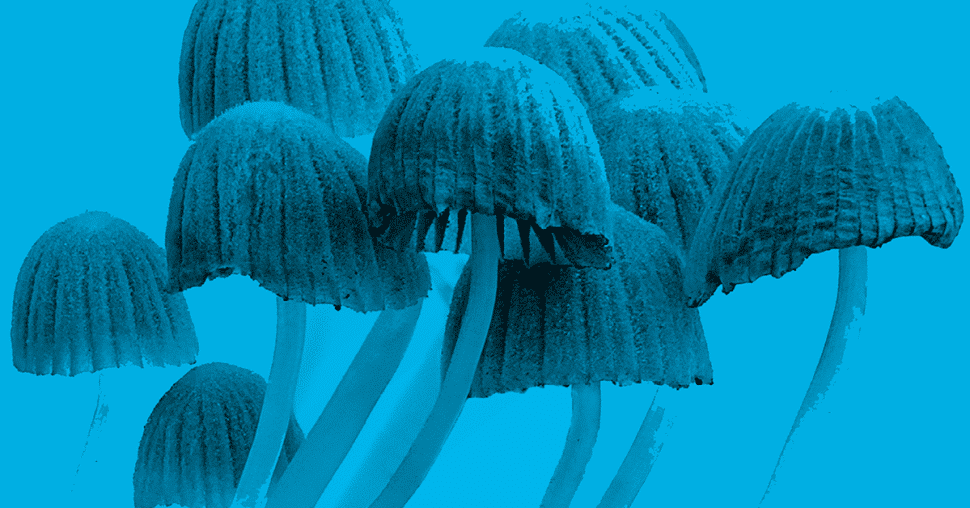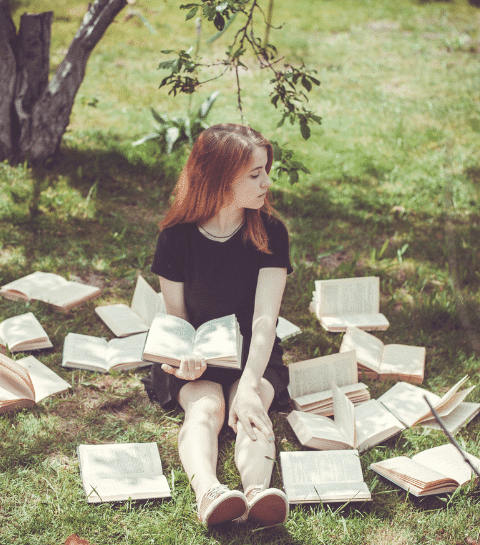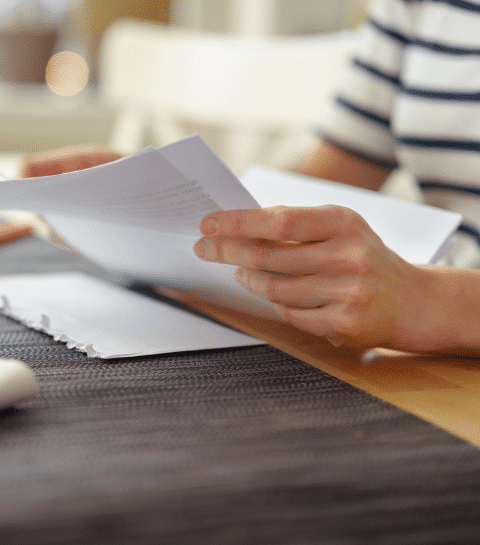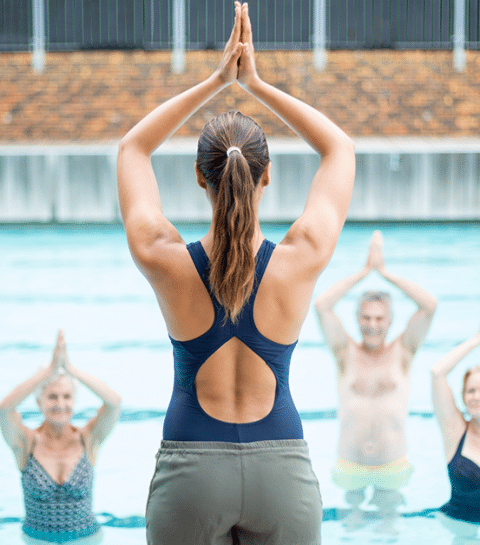Il y a celles auxquelles nous nous préparons mentalement, celles que nous subissons mais aussi celles que nous espérons. Dans Nos dernières fois, son nouvel essai, la philosophe s’intéresse à ces moments sans après et aux enjeux existentiels qu’ils sous-tendent.
Tout a commencé par une fête d’adieu à une maison de famille…
S.G. : Oui. C’est une expérience vécue il y a deux ans. J’ai été conviée par une famille à venir fêter avec eux leurs derniers moments dans une maison. Ils avaient organisé des adieux. C’était à la fois joyeux et poignant. Ils se séparaient d’un domaine possédé depuis un siècle et dont chaque génération avait pris soin. C’était un refuge pour eux. Ce moment, très sensible, m’a énormément touchée. Il a ressuscité mes propres dernières fois. C’est drôle d’organiser une dernière fois… C’est peut-être un fantasme, me suis-je dit, parce que précisément, le plus souvent, nous ne pouvons pas anticiper ou préparer la dernière fois.
On voudrait à la fois pouvoir l’honorer et, en même temps, si on en avait toujours connaissance, ce serait insupportable. J’avais envie d’explorer cette ambiguïté : des dernières fois désirées, redoutées, organisées. Voilà le charme du temps, à la fois merveilleux et précieux, qui file et nous laisse dépossédés.
Il existe selon vous trois types de dernière fois, est-ce que vous pourriez les détailler ?
S.G. : Il y a les dernières fois que nous préparons, qu’il s’agisse d’un adieu à un lieu, un départ à la retraite ou le deuil d’un être qu’il faut accompagner. Je me demande s’il est vraiment possible d’anticiper complètement cet instant. Concernant les êtres, je ne le crois pas car il y a toujours une part du vécu qui échappe à notre imagination, surtout quand il s’agit de la mort. Puis les dernières fois que nous subissons et qui donnent une impression de dépossession comme de fracas. Se trouver quitté par un ami ou un amour, subir une disparition, sinon une mort soudaine. Enfin, les dernières fois que nous décrétons par la volonté et qui représentent un horizon de délivrance. Est-il vraiment possible de décréter que c’est la dernière fois pour que ce soit le cas ? Je ne le pense pas. Les dépendances et l’emprise ne s’évanouissent pas par le volontarisme.
Dire « C’est fini » ne suffit pas ?
S.G. : Non, cela ne met pas fin à nos désirs, à ce qui nous obsède, à ce qui est entêtant. Car ce que nous vivons et éprouvons dans le temps est de nature processuelle. Pour nous encourager, nous prenons un décret pour essayer de mettre de l’ordre dans notre vie, une sorte de balise temporelle. En réalité, le temps de la vie et celui des sentiments ne se déroulent pas selon nos découpes. Le temps est de nature continue mais aussi hétérogène : chaque moment est de nature différente, riche d’imprévisible. Le passé, le présent et le futur s’entremêlent, s’enchevêtrent comme une mélodie vivante, organique. C’est cela, la durée, et non nos séquençages intellectuels.
Vous voulez dire que les dernières fois n’existent pas ?
S.G. : Je pense que la dernière fois, le plus souvent, n’est pas une fin. Les réflexions et les sentiments occasionnés par la relation perdurent tant que nous sommes enchevêtrés dans une intrigue affective. S’il y a une dernière fois et une fin sur un plan physique, nos sociétés matérialistes et scientistes nous font oublier que sur les plans spirituel, affectif, rien ne s’arrête. Ou très rarement. Il est possible parfois que quelqu’un ne vienne plus du tout nous obséder, ne soit plus du tout dans nos pensées, que nous n’entretenions plus rien avec lui, mais c’est très rare. Par ailleurs, la question d’une vie après la mort est insoluble et demeure ouverte. Tout continue sur le plan de l’esprit.
Même dans le cas d’une dernière fois que l’on espère, d’une volonté d’en finir, de rompre ?
S.G. : Certes, nous pouvons aspirer à la dernière fois pour mettre fin à des situations insupportables, intolérables et nous libérer d’une emprise, sinon d’une addiction. Mais décréter la fin est le plus sûr moyen de rester obsédés par ce que nous continuons, au fond, à désirer. En fait, il ne s’agit pas de se fixer un compte à rebours ou de faire les comptes, de décréter une dernière dose, il s’agit plutôt de réorienter son désir, de modifier son rapport qualitatif à la substance ou à la personne : « Je désire de l’ivresse, de l’intensité, mais je constate que cela m’empêche d’aimer, d’être aimé ou de travailler, est-ce que c’est un rapport vraiment désirable à ma vie ? Qu’est-ce que je veux réellement dans mon existence et dans mon rapport à moi-même ? » Ou s’apercevoir que l’objet de son désir ne répond pas à ce désir : « Je veux être aimé pleinement, mais je ne le suis pas par cet être. » Le décret volontariste de la dernière fois ne met pas fin à l’obsession et à l’attachement. Il ne permet pas un sevrage, il excite la peur de perdre. Il faut assumer son obsession et opter pour une balance qualitative : « Est-ce que ça m’apporte plus de douleur ou de plaisir ? »
C’est souvent ce qui se passe en thérapie : les patients viennent consulter parce que, à un moment donné, la souffrance excède largement le plaisir…
S.G. : Oui. C’est dans ces moments-là que le questionnement surgit : « Est-ce que vraiment cette personne, ce produit, cet objet, cette activité m’apporte autant de bien qu’au début, ou autant que je le crois ? Et qu’est-ce qui fait que je m’y aliène ? Est-ce que cela répond à mes désirs profonds ? » Parfois, c’est un rapport masochiste, une mésestime de soi, un manque de confiance en soi qui alimentent ces objets ou des désirs inintéressants : nous n’osons pas désirer des choses désirables, réjouissantes, belles ou énergisantes. C’est tout un travail à mener sur soi pour établir la qualité que nous voulons nous apporter à nous-mêmes et aux autres.
Ce travail, comment le mettre en oeuvre à votre avis ?
S.G. : En questionnant son plaisir. Souvent, nous sommes persuadés que ce qui nous obsède nous fait du bien, nous est indispensable intellectuellement ou physiquement. Mais dans une situation d’addiction ou d’emprise, le plaisir reçu est de très courte durée. Il est toujours interrompu par la douleur. C’est ce que disent les épicuriens : le plaisir est toujours bon, mais inscrivez-le quand même dans un rapport au temps. Il y a des plaisirs immédiats qui provoquent beaucoup de souffrances, l’excès d’alcool, par exemple. Quel est l’intérêt de se donner un plaisir à court terme qui produit à long terme un effet beaucoup plus douloureux ? Il y a des douleurs à court terme qui sont sources de plaisirs durables, par la fierté que nous avons eue de surmonter les difficultés. Il y a des exigences envers soi qui font souffrir dans l’immédiat, mais qui libèrent énormément de plaisir. Il faut savoir faire évaluer qualitativement le plaisir (est-il intéressant, bénéfique, utile ?) et temporellement (est-ce qu’il m’installe dans une durée supportable ?). Souvent, par habitude ou par mimétisme, nous considérons que tel plaisir est indispensable. Mais en se recentrant sur son ressenti, ce plaisir d’une heure provoque une souffrance qui dure des semaines. Il faut questionner cette envie de nourrir quelque chose qui ne répond que très partiellement à notre désir de jouissance et qui s’avère plus profondément décevant.
Comment bien se préparer à une dernière fois, quand elle est prévisible ?
S.G. : Rendre hommage à un lieu ou à un lien que l’on veut quitter et attester du passé heureux est une chose belle. Quant à l’ultime dernière fois, la mort, c’est un étalon qui permet d’évaluer et d’améliorer la qualité de nos rapports. Quand nous avons en tête que les êtres peuvent prendre fin, nous nous investissons mieux ; nous apportons plus de qualité à nos gestes, à nos paroles ; nous cultivons plus de sérieux, d’authenticité, de beauté aussi. La mort doit améliorer le rapport qualitatif à la vie, mais ne doit pas devenir un compte à rebours qui engrange un décompte de ces instants. Parce qu’à ce moment-là nous devenons otages d’un budget temporel. Et là, ça devient intolérable. Nous courons toujours après, nous sentons toujours en défaut. Le rapport aux autres, à soi, au temps s’appauvrit. Ne tombez pas dans une peur qui vous pousserait à compter et à thésauriser. Ça, c’est un piège.
N’est-ce pas un peu compliqué, alors même que nous vivons dans une société qui pousse précisément à ça ?
S.G. : Absolument. Nous vivons dans une culture comptable et une société de l’urgence, où tout change très vite. Mais le rôle de ceux qui écrivent est de rappeler que le temps n’est pas l’emploi du temps. Comme dirait le philosophe Bergson, chaque moment a une qualité, une tonalité ou une couleur. J’ajoute que le temps est la première des richesses. Ce n’est pas une chose que l’on détient, mais c’est un plan de la réalité au niveau duquel on peut se hisser et s’installer pour vivre mieux. La durée est ce qui nous permet d’exister, de mûrir, de créer, d’aimer. Osons la rejoindre. La première résistance est là : ne pas se laisser voler son temps, se laisser vivre dans sa durée, l’éprouver pour apercevoir sa beauté. Ne pas hésiter à dépenser son temps par la paresse, la contemplation, les moments volés avec des êtres aimés. Chaque instant est ultime et unique, toujours déjà passé. Comment affronter l’irréversible ? L’une de mes réponses consiste à rappeler que compter, c’est perdre, dépenser généreusement rend au centuple. Une autre est de rappeler que l’adieu aux choses matérielles n’est pas la fin de la vie de l’esprit et du coeur. Même lorsqu’un coup d’arrêt nous prend de court, il y a de la continuité. Les liens perdurent. Ce qui a été vécu de beau, de bon, de joyeux ne disparaît jamais.
À lire : Nos dernières fois de Sophie Galabru
La nostalgie n’est plus ce qu’elle était, pourrait écrire Sophie Galabru. Dans son nouvel essai, elle se penche sur cette question de la fin. Ce rapport au temps, propre de l’être humain, est l’un des grands sujets de la phénoménologie, courant auquel se rattache la jeune philosophe. Elle réussit ici à rendre accessibles des notions complexes, qu’elle articule généreusement pour proposer une conception éthique et réjouissante de la vie (Allary éditions, 220 p., 20,90 €).
Texte : Hélène Fresnel
Juliette Paulet – Allary Editions