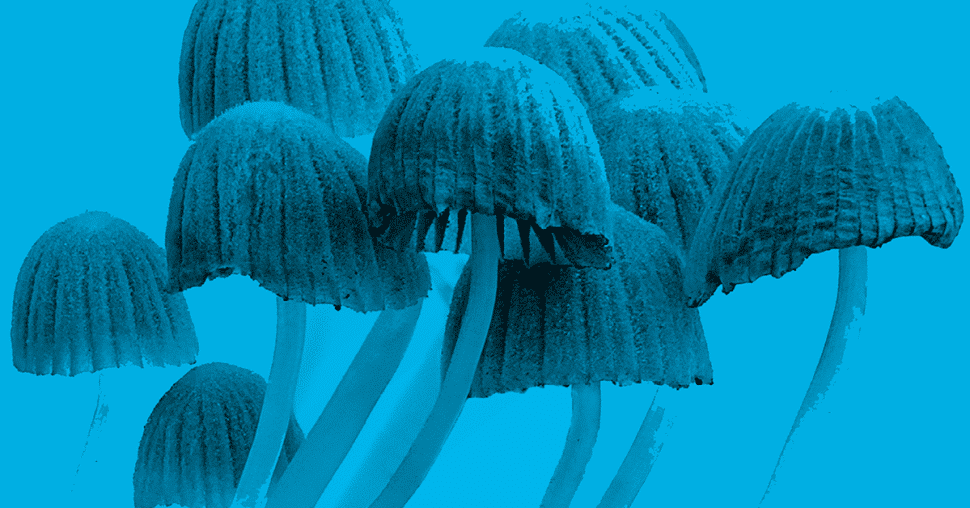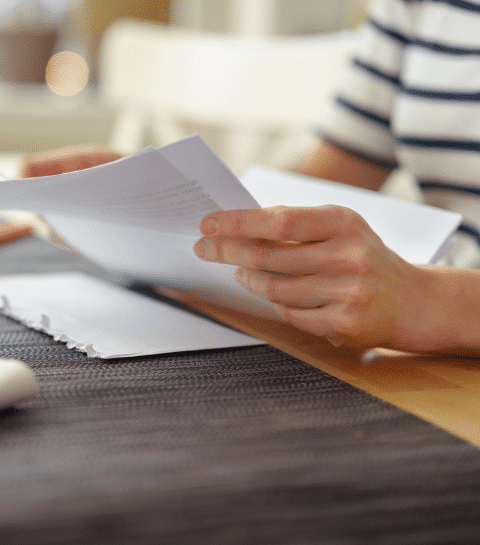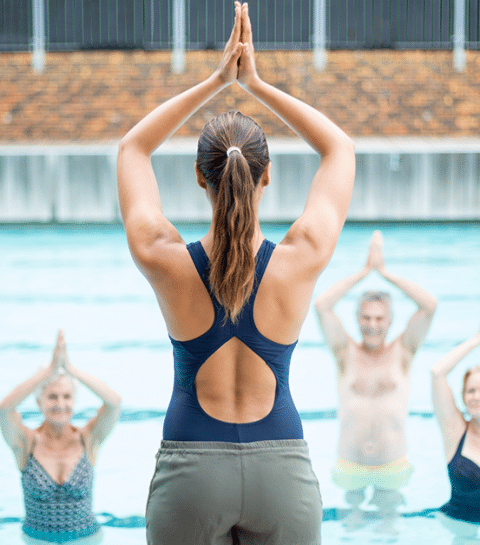Quitter ce job ou pas ? Déménager tout de suite ou dans un an ou deux ? Se séparer ? Enfiler une robe ou un jean ?… Du plus anodin au plus grave, nos choix sont autant d’exercices périlleux qui mettent en jeu nombre d’instances contradictoires en nous, et génèrent parfois une intense agitation émotionnelle. « Choisir engage le sujet, décrypte la psychanalyste Paz Corona. C’est une plongée dans le vide, un pari. Le résultat n’est jamais garanti. Mais si on ne le fait pas, entravé par telle ou telle raison, comment avoir l’idée de ce que l’on aurait pu créer dans l’avenir ? »
Les affres du libre arbitre
Quoi de plus déstabilisant que cette rencontre avec notre libre arbitre, ce face-à-face avec l’incertain, l’inconnu, la hantise de « se tromper », de perdre éventuellement ce que l’on a déjà, et la difficulté de devoir renoncer aux autres opportunités qui se présentent. « L’irrésolution est le pire de tous les maux », écrivait déjà Descartes. Il ne se doutait pas que, quelques siècles plus tard, cela pourrait devenir un syndrome généralisé dans une société du tout possible qui nous rend de plus en plus intolérants à la frustration, sévères envers l’erreur et affolés par la nécessité de nous décider. Un peu comme de grands enfants menacés dans leur toute-puissance à l’heure de renoncer à l’infini des possibles. « Nous avons tendance à anticiper le regret que nous aurons d’avoir pris une décision avant même de l’avoir prise, explique le psychiatre David Gourion1. […] C’est ce que révèlent des recherches en psychologie cognitive axées sur la dimension émotionnelle douloureuse de la prise de décision, un sentiment de mécontentement, de tristesse et d’aversion envers “l’erreur”. Nous avons du mal à accepter que nous ne sommes pas des êtres parfaits et que, malgré nos intelligences et nos complexités, notre cerveau n’est pas une excellente machine à prédire. »
L’ère de la fatigue décisionnelle
Face à l’extension du domaine des possibles, la « fatigue décisionnelle » est devenue un phénomène de société. Et l’embarras du choix, moins un gage de liberté individuelle qu’une source de pression. Nous voilà pris au piège de cette « modernité liquide » mise en lumière dès les années 2000 par le philosophe Zygmunt Bauman2 : une société où la culture de l’abondance et la démultiplication des options individuelles génèrent angoisse et instabilité sociale. Tout le « paradoxe du choix », également décrit par le psychologue américain Barry Schwartz3 : le « trop de choix » peut conduire à la paralysie, au regret et, paradoxalement, nuire au bien-être au lieu de l’améliorer. « Tout est là, et pourtant c’est beaucoup trop. Je suis le roi, je peux tout choisir, mais je suis fatigué à la simple idée de devoir le faire », résume deux décennies plus tard, dans Submersion (Grasset, 2023), le journaliste Bruno Patino, actuel président d’Arte. Ultramoderne épuisement.
Mais avons-nous, en réalité, autant d’options qu’il y paraît ? Le plus grand inconfort, quand il s’agit de prendre une décision, ne tient-il pas plutôt à la sensation chaotique d’être à la fois accablé par le poids de notre liberté et agi par un faisceau de forces qui nous dépassent ?
Le poids des conditionnements inconscients
Le libre arbitre ne serait-il pas une douce illusion ? Qui décide en nous, en réalité, lorsque nous décidons ? Le sujet inspire les philosophes depuis que la philosophie existe, et la littérature ne fait qu’explorer à la loupe l’influence des forces obscures de l’inconscient sur les choix existentiels de ses héros. Pulsions refoulées, instinct profond, héritage social… De multiples raisons que la raison ignore sont convoquées à notre insu lorsque nous nous efforçons de nous décider « en toute connaissance de cause ». « En analyse, on réalise que souvent dans nos décisions, même les plus importantes, on a réagi sur un détail infime, et notamment sur des mots, des signifiants qui nous ont comme “happés” », décrypte Ali Magoudi4. Dans son « autobiographie analytique », Le Monde d’Ali (Albin Michel, 2004), le psychanalyste décrit comment nous sommes téléguidés dans nos choix par des forces plus puissantes que nos arguments rationnels. Comment, par exemple, on peut décider de devenir chirurgien non pas, comme on se le raconte, parce que c’est un beau métier, mais pour soigner ses parents ou se soigner soi-même : « On se donne sans cesse des justifications qui n’ont rien à voir avec les multiples causalités inconscientes qui ont présidé à notre choix », écrit-il.
Gare aux chants des sirènes
Mais il n’y a pas que la grille analytique. Les déterminants sociaux sont tout aussi actifs dans nos prises de décision : notre position sociale, notre éducation, nos habitudes culturelles, tous les codes de notre milieu, mais aussi les influences plus ou moins avouées de la société qui nous entoure. Dès les années 1970, Jean Baudrillard avait fait la critique de « la société de consommation », dans laquelle les normes en vigueur, les modes et les stratégies de marketing orientent nos choix et donnent une illusion de liberté plutôt qu’un pouvoir réel de décision. Ont suivi les années glorieuses de la pub, et nous voilà aujourd’hui soumis au pouvoir sournois des nudges. Ces stimuli discrets censés aider les individus à prendre les meilleures décisions et faire les « bons » gestes, sans les forcer et l’air de rien, guident notre comportement (en plaçant par exemple les yaourts à la hauteur des yeux sur les présentoirs de la cantine, pour nous inciter à les mettre sur notre plateau plutôt que des gâteaux). Gare à la manipulation. Les algorithmes, eux, sous couvert de s’adapter à nos goûts, finissent par décider à notre place, ou du moins orienter fortement nos choix (amoureux, vestimentaires, politiques, culturels…) en nous soumettant des contenus censés nous correspondre, des relations faites pour nous, des produits de consommation adaptés à notre mode de vie… Comment rester aux commandes de nos choix ?
Vers des choix vraiment bons pour soi
« Nous sommes certes très fortement conditionnés, très fortement influencés, reconnaît le philosophe Charles Pépin5. Notre liberté est fortement menacée, mais elle se conquiert, peu à peu, laborieusement, dans le tâtonnement et la difficile connaissance de soi, de ce soi traversé par tant d’autres choses que soi. » Le bon choix ne sera jamais celui que nous dictent les nudges, les algorithmes, les influenceurs des réseaux sociaux, ni même les injonctions de nos juges intérieurs. Mais bien celui qui nous aligne à notre désir profond. La psychanalyse reste la voie royale pour se rapprocher de cette vérité de soi, et réussir à faire des choix aussi libres que possible. Mais tout travail d’introspection peut aider à faire taire le chant des sirènes, se mettre à l’écoute de soi, et apprendre à choisir ce qui est vraiment bon pour soi. « La vraie sagesse, suggère David Gourion, c’est la capacité de prendre du recul, se remettre en question, sonder les méandres de notre inconscient, prendre conscience du décalage entre ce qui semble évident et la petite vérité qui scintille au fond de nous, où réside souvent la clé de la décision éclairée. » Tout l’art du discernement, en somme : apprendre, au fil du temps, à faire la part des choses entre ce qui nous appartient ou pas, à renoncer de plus en plus vite et sans douleur à ce qui n’est pas nous. Et à deviner, derrière une « mauvaise décision », les chemins dérobés de la « bonne ». C’est dans ce pas à pas assidu que l’on finit par prendre des décisions de plus en plus satisfaisantes, et par mener enfin une vie qui nous ressemble.
1. David Gourion, dans L’Inconscient, « Qui choisit pour moi, comment l’inconscient influence nos décisions ? », France Inter, 15 octobre 2023 (et en podcast sur radiofrance.fr). 2. Zygmunt Bauman, dans Liquid Modernity (Polity, 2000), puis La Vie liquide (Hachette, “Pluriel”, 2013). 3. Barry Schwartz, dans Le Paradoxe du choix, et si la culture de l’abondance nous éloignait du bonheur ? (Marabout, 2009). 4. Ali Magoudi dans les pages de notre journal, interviewé par Pascale Senk en juillet 2009. 5. Charles Pépin, dans La Question philo, « Avons-nous toujours le choix ? », France Inter, 16 mars 2024 (et en podcast sur radiofrance.fr).
Texte : Marie-Claude Treglia