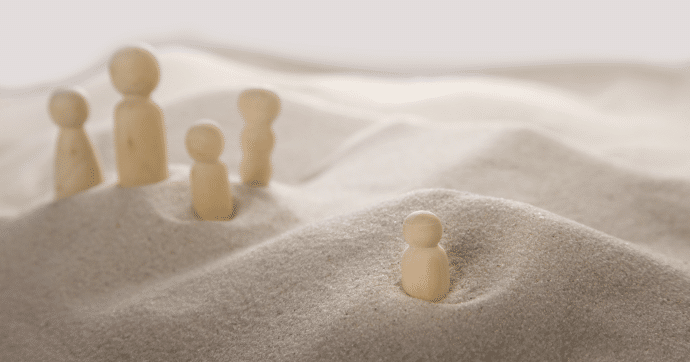Nous n’en avons pas conscience mais nous passons notre vie à prendre des décisions. La moindre de nos saccades oculaires est le fruit d’un choix effectué par notre système cérébral. Comment tout cela fonctionne-t-il ? Les explications de Sylvie Chokron, neuropsychologue et chercheuse au CNRS.
Combien de décisions le cerveau humain prend-il chaque jour ?
S.C. : Le nombre est infini et inchiffrable. Les décisions peuvent faire suite à des perceptions de l’intérieur ou de l’extérieur de notre corps. Elles peuvent être conscientes ou non conscientes. Les non conscientes sont en général très rapides, automatiques, irrépressibles et souvent liées à un contexte. Votre cerveau a perçu quelque chose et estime que vous devez y répondre. Quand vous êtes face à quelqu’un et que vous souriez par exemple, vous pensez que « c’est émotionnel ». Mais non ! En fait, c’est votre cerveau qui a pris la décision de vous faire imiter le sourire de l’autre, et vous, vous n’en avez pas conscience. C’est une perception qui a généré la décision. Je vous donne un autre exemple : votre cerveau peut aussi décider si vous devez continuer à être en interaction avec une personne en ajustant ou pas la taille de votre pupille à celle de votre interlocuteur, car c’est une marque d’attention qui influe sur la relation. Il décide pour vous si vous pouvez (ou pas) avoir confiance dans l’autre, sans que vous le sachiez. C’est un système très rapide, lié à l’amygdale, cette petite structure qui réagit à la peur, au danger, et nous incite à nous approcher ou au contraire nous éloigner de quelque chose. La prise de décision n’est pas forcément volontaire. Elle peut être une forme d’adaptation à une situation.
Et les décisions conscientes ?
S.C. : La prise de décision consciente, quant à elle, est plus lente. Elle implique de la réflexion. Elle suit une voie complexe qui repose sur la perception, l’analyse et la comparaison avec ce qu’on connaît déjà. Dans toutes les professions, il y a de la prise de décision en permanence. Un chef d’entreprise, un manager, un médecin prennent des décisions toute la journée : j’investis, je n’investis pas ; je donne des médicaments, je n’en donne pas ; j’envoie faire un examen… Mais même si vous n’avez pas une activité intellectuelle très assidue, vous prenez quand même des décisions toute la journée : qu’allez- vous manger, dire ? Quel mot employer ? Où sortir ? Ces décisions mettent en jeu beaucoup de régions dans notre cerveau, en particulier notre cortex frontal, qui est l’aire du jugement critique, du raisonnement, de l’adaptation sociale. C’est lui qui nous intime par exemple l’ordre de ne pas nous déshabiller dans la rue.
Au coeur de notre prise de décision consciente, il y aurait donc trois systèmes : le 1, intuitif, émotionnel, rapide ; le 2, réfléchi, cognitif ; et le 3, qui inhibe le système 1 et permet au système 2 de se déployer ?
S.C. : Je n’aime pas trop l’idée du système 3. Je pense qu’en temps normal les deux premiers systèmes que vous citez fonctionnent en parallèle. Nous avons besoin des deux. Par exemple, quand nous sommes en face-à-face, vous et moi, je suis influencée par tous les signaux perceptifs que je perçois de vous : « Est-ce que vous comprenez ? », « Est-ce que vous ne comprenez pas ? », « Est-ce que vous avez l’air attentive ? », « Est-ce que vous avez l’air intéressée ? » Tout ça conditionne aussi mon discours. C’est un peu réducteur d’imaginer que nous possédons un troisième système qui permet d’équilibrer les deux. Je pense que les deux systèmes collaborent en permanence.
Est-ce que parfois l’un peut prendre le pas sur l’autre ?
S.C. : Oui, par exemple en situation de stress, nous avons plus de mal à prendre des décisions rationnelles, à réfléchir, parce que le stress sidère en quelque sorte notre cerveau, l’empêche de mettre en oeuvre ses capacités les plus élaborées. Il favorise un raisonnement plus émotionnel, plus intuitif, plus défensif pour s’adapter vite à un contexte effrayant. De la même manière, dans une relation affective avec nos enfants, nos parents, nous n’avons pas du tout la même objectivité que dans un autre contexte. Nos décisions sont impactées non seulement par des émotions négatives, comme le stress, l’angoisse, la dépression, mais aussi par des émotions positives. À chaque instant, les deux systèmes peuvent influer l’un sur l’autre. Quand vous êtes emportée par le stress, l’émotion, tout à coup vous pouvez prendre du recul et vous dire : « Non mais ça, c’est débile, je fais ça parce que j’ai envie d’être une bonne mère, mais en fait c’est une fausse bonne idée, parce que, d’un point de vue rationnel, il ne faut pas que je gâte et pourrisse mon enfant. » Ces deux systèmes sont tout le temps là, en nous.
Qu’est-ce qui bloque la prise de décision ? Est-ce le stress ?
S.C. : C’est une question intéressante. Nous savons aujourd’hui que nos capacités cognitives nous permettent, intuitivement mais aussi en nous appuyant sur des faits stockés en mémoire et sur notre raisonnement, de prendre des décisions ; sauf que, dans certains cas, nous sommes bloqués par une inhibition intellectuelle. Cette inhibition surgit dans certains contextes où nous n’arrivons plus à raisonner. En situation de harcèlement, de submersion émotionnelle ou intellectuelle, de dépression, de maladie, de deuil, de gros soucis pour soi, pour un proche ou quoi que ce soit, l’un des premiers processus cognitifs à être altéré, c’est la prise de décision. Les gens qui sont déprimés, sujets à un trouble anxieux, vous le disent très bien d’ailleurs : décider ce qu’ils vont manger, à quelle heure ils vont manger, ou même décider où ils vont aller faire le marché, leur est extrêmement difficile. L’indécision est une forme d’absence de pensée, d’absence de résolution de problème.
En psychothérapie, de nombreux patients arrivent en disant : « Je passe mon temps à répéter des situations et à prendre de mauvaises décisions ». Comment expliquez-vous ce phénomène de répétition ?
S.C. : Du point de vue neuroscientifique, la répétition, c’est l’absence de prise de décision pensée. Vous avez mis en place une heuristique, un raccourci mental : vous avez répondu par le passé à une situation et n’avez pas remis en question le résultat de votre action. Votre pensée est court-circuitée. Au moment de prendre une décision, au lieu de vous appuyer sur les décisions précédentes et la critique du résultat obtenu, vous ne vous autorisez pas ce regard réflexif, vous ne parvenez pas à sortir du cadre dans lequel vous avez à chaque fois pris les mêmes décisions. Il manque un mécanisme de réflexion, une mise en miroir de la nouvelle décision à prendre en fait. Souvent, les gens qui hésitent font une colonne d’avantages et une d’inconvénients pour décider. Je considère que c’est une totale absurdité, parce que les arguments que vous mettez de chaque côté n’ont jamais le même poids. Ce qui permet de prendre une bonne décision, c’est l’argument qui va peser le plus lourd au moment précis où vous la prenez. Les aspects affectifs, émotionnels, cognitifs, la mémoire, le résultat de nos actions précédentes, tout le contexte autour de nous rentrent en ligne de compte. Et la bonne décision, c’est la décision qui a intégré tous ces facteurs.
Les personnes qui ont le sens des bonnes décisions auraient donc la capacité de prendre en compte tout cela…
S.C. : Oui. Imaginons que je vienne de me séparer. Je me retrouve seule avec mes enfants. C’est vraiment très difficile. Et imaginons qu’au même moment, j’en aie ras le bol de mon métier. Évidemment, je ne vais pas démissionner de mon poste, qui me permet d’avoir un salaire tous les mois ! La bonne décision tient compte des aspects affectifs, cognitifs, mnésiques, contextuels. Mais ceux qui prennent de bonnes décisions ne sont pas plus forts ou plus doués que les autres. Leur aisance vient du fait qu’ils prennent des décisions régulièrement et savent analyser leurs résultats, c’est-à-dire qu’ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ont fait preuve d’introspection, se sont montrés capables de se critiquer, voire d’analyser les bénéfices secondaires qu’ils ont pu trouver à la prise de mauvaises décisions. Et leur cerveau a automatisé en quelque sorte des routines pour les décisions complexes, car il y a énormément de circuits en jeu, les aires perceptives – ce que vous percevez –, les aires qui analysent, qui reconnaissent, qui jugent l’importance, la pertinence : votre cortex frontal, votre système mnésique, votre circuit de la récompense… Quasiment tout votre cerveau est actif quand vous prenez une décision, et cela nécessite également du temps, pour laisser infuser tous les arguments et permettre à votre cerveau de peser le pour et le contre, et d’arbitrer. Le problème est que nos modes de vie actuels ne favorisent pas la mise en place des circuits de décision car ils nous exposent à devenir des machines à répondre le plus vite possible à des stimulations.
Nos modes vie nous empêchent de prendre des décisions ?
S.C. : Autrefois, quand nous étions au travail, nous ne pouvions pas aller faire du shopping. Aujourd’hui, plus vous travaillez sur votre ordinateur, plus vous êtes exposé à des annonces, à des tentations d’acheter parce qu’un pop-up est monté sur votre écran. Vous n’avez pas pris la décision de vous rendre dans un magasin, de vous demander si ça vous allait. La réflexion associée à la prise de décision est réduite, voire niée. Les algorithmes décident pour vous. Mon inquiétude est de voir se réduire la prise de décision, consciente, réfléchie, rationnelle, intégrée. Il devient de plus en plus difficile d’exercer nos capacités de contrôle. Nous le voyons très concrètement avec les surdiagnostics des troubles de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adultes. Ce ne sont souvent pas des vrais troubles au sens où ils sont définis en clinique. Ce sont plus vraisemblablement des troubles du contrôle. Et qui dit troubles du contrôle, dit troubles des fonctions exécutives, les fonctions les plus élaborées d’organisation, planification, flexibilité mentale, de jugement critique, qui nous permettent de savoir ce que nous faisons, ce que nous aimons ou pas, de décider. Nous devons les cultiver. Cela demande du temps, de l’effort, mais en même temps, le retour sur investissement est colossal. Les fonctions exécutives sont au coeur de notre singularité, de notre liberté.
À lire : Plongez dans votre cerveau de Sylvie Chokron
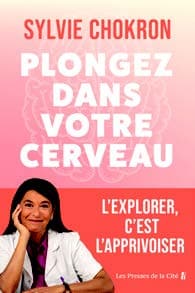
Un ouvrage très éclairant pour mieux comprendre le fonctionnement cérébral et le cerveau, « notre meilleur ami » (Presses de la Cité, 228 p., 19,90 €). Et sur Instagram, notre booktok (@psychologies).
Texte : Hélène Fresnel