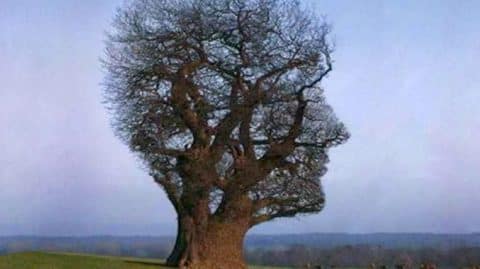Il faut se fier à son intuition
Plutôt vrai. Pour Émeric Lebreton, la réponse est oui : « Si une idée nous traverse l’esprit et qu’elle nous fait vibrer, alors elle vaut la peine d’être suivie, en tout cas prise au sérieux. Sans nécessairement attendre des confirmations, il est toujours utile d’écouter notre petite voix intérieure. » Celle-ci exprime forcément quelque chose d’important pour nous puisque l’intuition ou l’instinct, autrement dit l’inconscient, n’est jamais sans fondement. « Alors que nous essayons de faire des choix rationnels, nous nous apercevons souvent que nous sommes mus par quelque chose qui nous échappe, relève Valentine Hervé. La question du choix est liée à un conflit entre deux forces opposées : le désir et ce qui lui résiste. » Ainsi, nos croyances, nos affects, mais aussi notre histoire, porteuse de valeurs auxquelles nous sommes attachés, s’expriment à notre insu.
Pour faire un choix au plus près de qui nous sommes, il convient donc de leur laisser la parole. Mais pas toujours. Cathy Assenheim rappelle une évidence : « Si la décision doit être prise dans un domaine dans lequel nous avons de l’expérience, ou concernant un sujet sur lequel nous possédons des connaissances, alors, en effet, l’intuition est un bon guide puisqu’elle repose essentiellement sur ce que nous avons mémorisé en amont, donc vécu ou appris. En revanche, si nous sommes en terre inconnue, mieux vaut prendre le temps du recul. » Idem si cette fulgurance surgit alors que nous sommes débordés par l’émotion, qu’elle soit positive comme l’enthousiasme ou tétanisante comme la peur.
Il faut lister les “pour” et les “contre”
Vrai et faux. Selon Cathy Assenheim, l’idée est plutôt bonne : « Noter noir sur blanc les éléments favorables et défavorables à telle ou telle option aide le cerveau à les évaluer. Cela structure le raisonnement. Mieux vaut toutefois limiter l’exercice et nous en tenir à l’exploration de trois possibilités. Au-delà, nous risquons de tomber dans une forme de paralysie et d’y rester bloqués, parfois pour longtemps. » C’est ici que surgit le FOBO ( fear of better options, le sentiment de passer à côté de la meilleure opportunité) ou le FOMO ( fear of missing out, le sentiment de rater quelque chose). L’irrésolution, comme son nom l’indique, ne résout rien et empire la situation.
« Moins nous réussissons à trancher, plus nous angoissons ; et plus nous angoissons, moins nous parvenons à trancher, reconnaît Valentine Hervé. Le choix peut impliquer une prise de risque, il est peu ou prou un pari sur l’avenir, le souhait d’apporter un changement quand nous avons le sentiment de nous enliser dans une situation qui ne nous convient pas. » Émeric Lebreton confirme que « les listes de “pour” et de “contre” donnent l’illusion de contrôle mais enferment dans un cercle vicieux d’hésitation. Pendant que nous pesons chaque argument, la vie, elle, continue. Il y aura toujours des “contre”, donc des raisons de ne pas choisir l’une ou l’autre de nos options. Quant aux “pour”, ils existent moins avant de nous engager qu’après ; nous les créerons en chemin. »
Il faut toujours prendre son temps
Vrai, mais. « Qui va piano, va sano » d’après le dicton. Et ce n’est pas faux. « La précipitation empêche le cerveau de passer par l’entièreté du processus décisionnel, qui repose sur plusieurs étapes : le temps de l’émotion ou de l’intuition d’abord, celui du raisonnement ensuite, et enfin celui de l’action », rappelle Cathy Assenheim. Voilà pourquoi il vaut mieux nous montrer patients. « Le temps est un allié dans la mesure où, après une phase d’incubation, de gestation, la décision semble tomber comme un fruit mûr », approuve Valentine Hervé.
Les délais permettent d’écouter et d’éclairer nos motivations profondes, nos désirs parfois contradictoires. Quitte à y renoncer, mais en conscience cette fois, s’ils vont à l’encontre de nos valeurs, s’ils dépassent nos capacités ou s’ils nous mettent trop en insécurité. Cela dit, lorsqu’il s’agit d’une décision qui n’a guère de conséquences, n’attendons pas trop longtemps, au risque de ne plus agir. « Nous pourrons toujours voir ensuite comment l’ajuster », rassure Émeric Lebreton. Mais surtout, prendre du temps ne suppose pas de ne rien faire, même quand il s’agit d’un choix existentiel. « Avant de changer de métier, nous pouvons faire un bilan de compétences ; avant de déménager dans une autre région, commencer par y partir en vacances ; et avant de divorcer, expérimenter la rupture provisoire. C’est par l’action que nous saurons si nous sommes sur le bon chemin », poursuit-il.
Il faut demander l’avis de ses proches
Vrai, sous condition. La démarche n’est pas infondée, comme l’indique Émeric Lebreton : « Si nous considérons qu’un avis extérieur peut nous être utile, choisissons une personne suffisamment objective. Vouloir l’avis des autres, c’est humain parce que cela rassure. Mais le problème est que celles et ceux qui nous aiment veulent avant tout nous protéger. Ce qui peut vouloir dire nous freiner, car ils auront tendance à projeter leurs propres peurs sur nous. »
Il convient donc de nous méfier de ce phénomène, très humain, de projection. « Mes patients me demandent souvent ce que je ferais à leur place, confie Valentine Hervé. Comme si je savais mieux qu’eux quel est leur désir ! Je suis là pour soutenir ce dernier, non pour dispenser de bons conseils ou autres leçons de vie. » Voilà pourquoi il est préférable de nous ouvrir auprès d’un interlocuteur qui nous accompagne dans la réflexion, qui interroge nos hésitations. D’autant qu’à multiplier les sons de cloche, nous pourrions obtenir des opinions contraires. « Si notre entourage possède des connaissances dans le domaine à propos duquel nous doutons, parce qu’il est passé par-là ou qu’il en a une certaine expertise, n’hésitons pas. Mais notre but doit être de récolter des informations, toujours bienvenues, pas de suivre à la lettre des prescriptions », prévient Cathy Assenheim.
Il faut avoir une grande confiance en soi
Vrai et faux. « La confiance en soi participe évidemment au processus de décision, estime Cathy Assenheim. Si nous pouvons nous appuyer sur des réussites du passé, si nous nous connaissons bien – nos talents comme nos limites –, si nous savons réguler nos émotions inconfortables et mettre à distance nos pensées automatiques, alors nous nous déciderons plus facilement. » Certes, cette assurance n’est pas donnée à tout le monde. Pour autant, elle se travaille et se construit. « Attendre de nous sentir prêts, c’est comme attendre de savoir nager avant de mettre un pied dans l’eau ! sourit Émeric Lebreton. La vraie question est donc : comment décider, même en tremblant un peu ? »
Ici, nous pouvons nous entraîner à prendre de petites décisions au quotidien, à faire des choix simples, au supermarché par exemple, ou devant notre penderie. Comme un muscle, ce processus s’entraîne, et c’est de cet entraînement que naîtra davantage de confiance.
Si nous ne parvenons pas à faire ces petits pas, sans doute faudra-t-il interroger notre fébrilité en thérapie. « Parfois, nous nous refusons le droit au bonheur, reconnaît Valentine Hervé. Nous sommes rattrapés par des pulsions destructrices qui semblent agir en notre défaveur : nous choisissons toujours les mêmes partenaires, par exemple, ou répétons des comportements addictifs. » Nous nous en voulons alors de manquer de confiance comme de volonté. Il peut être intéressant de nous retourner sur le passé pour avancer.
Il faut être mature, donc adulte
Plutôt vrai. Comme le rappelle Cathy Assenheim, « le cerveau n’atteint sa maturité qu’à l’âge de 18 à 25 ans. Très schématiquement, l’enfant est essentiellement guidé par ses émotions, l’adolescent commence à raisonner mais il manque d’expériences sur lesquelles se fier, et l’adulte, lui, est mûr pour faire le bon choix. » Sur le papier… Car les petits ont parfois de très bonnes capacités d’intuition, justement parce qu’ils sont au plus près de leur désir, et font fi du principe de réalité. Ils sont donc volontiers en mouvement.
« Certains enfants prennent des décisions plus courageuses que des adultes figés par la peur, admet Émeric Lebreton. La seule vraie maturité est celle qui nous permet de prendre en main notre vie et non d’attendre que la vie décide pour nous. » Certes, nous sommes adultes donc matures, mais cette socialisation qui a lissé nos aspérités et régulé nos pulsions de vie n’a pas que du bon. « Modelés par les convenances, nous pourrions choisir la voie de la raison et nous contenter d’un certain conformisme, au détriment de ce qui nous anime », regrette Valentine Hervé. Il est parfois sage d’écouter notre enfant intérieur, qui reste une boussole fiable.
Il faut être prêt à se tromper
Vrai. Une chose est sûre : nous ne pouvons pas prévoir l’issue de nos choix. « Nous prenons toujours le risque de traverser le temps du regret et son lot de “Je n’aurais pas dû”. Mais aucune décision n’est idéale. Il s’agit de faire un choix “suffisamment bon” pour soi, pour paraphraser la célèbre formule de Winnicott », affirme Valentine Hervé.
Cathy Assenheim invite à nous éloigner de l’idéalisme, qui n’est pas réaliste. « Si nous restons en quête d’une solution parfaite, nous passerons à côté de belles opportunités. Une “bonne” décision est celle qui répond le mieux à un besoin du présent, avec toutes les incertitudes qui sont liées au futur. Demain, elle s’avérera peut-être obsolète ou inadaptée. Il conviendra alors de réévaluer la situation, de réinterroger les différentes options et de nous engager dans un nouveau processus de décision. » L’échec fait partie du jeu mais il peut être appréhendé autrement. « Chaque erreur est une leçon qui nous rapproche du succès, estime Émeric Lebreton. Si nous refusons de nous tromper, nous refusons d’apprendre et, donc, nous refusons de progresser. »
Il faut forcément renoncer
Vrai. Oui, en effet. Choisir l’option A, c’est forcément fermer la porte à l’option B. « Et cela nous renvoie à la crainte de perdre ce que nous avons, ce que nous connaissons, pour nous trouver confrontés à ce que nous ne maîtrisons pas. C’est ce saut du déjà connu vers l’inconnu qui peut freiner la question du choix et nous enfermer dans des habitudes rassurantes », reconnaît Valentine Hervé. Cet inconfort est néanmoins passager. « Là encore, pour garder notre flexibilité mentale, il est important de conjuguer notre choix au présent. Il n’y a pas lieu de dramatiser ce renoncement », estime Cathy Assenheim. Bien au contraire, pour Émeric Lebreton : « Ce n’est pas une perte, c’est un investissement. Au lieu de voir cela comme un sacrifice, voyons-le comme une sélection naturelle de ce qui compte vraiment pour nous. Les personnes qui veulent tout garder finissent souvent par ne rien obtenir. »
Il faut parfois jouer à Pile ou face
Faux. « Ce n’est pas le hasard qui fait la réussite, prévient d’abord Émeric Lebreton. Les personnes qui semblent chanceuses sont souvent celles qui ont osé plus souvent que les autres. Plus nous tentons de choses, plus nous multiplions les expériences, et plus nous sommes préparés à prendre les bonnes décisions. »
Si l’enjeu n’est guère important et que la situation nous amuse, nous pouvons cependant nous en remettre au destin. « Pourquoi pas, en effet, relève Cathy Assenheim. Laissons-nous surprendre par le hasard de temps en temps. Mais sachons-le : il ne s’agit plus d’une décision ! » Plutôt que jouer à pile ou face, Valentine Hervé propose de nous mettre à l’écoute des manifestations de notre inconscient : « Les rêves, les lapsus ou les actes manqués peuvent nous faire découvrir d’autres facettes de nousmême et nous guider dans nos choix. » C’est une autre façon de nous surprendre, mais une façon bien plus fidèle à notre être profond.
Il faut mettre en oeuvre sa décision
Vrai et faux. La réponse est clairement oui, sinon nos voeux restent pieux. « Prendre une décision sans agir, c’est comme acheter un billet d’avion sans jamais partir en voyage, s’amuse Émeric Lebreton. Une décision n’a de valeur que si elle est suivie d’un passage à l’action. Nous avons dans l’idée de repeindre le salon ? Faisons un tour au magasin de bricolage. Nous voulons déclarer notre flamme à quelqu’un ? Envoyons-lui ce message important. Nous avons décidé de reprendre le sport ? Enfilons nos baskets, ne serait-ce que pour marcher une demi-heure. »
Dans certains cas, il n’y a pourtant pas lieu de nous obliger à agir. « Ne pas prendre de décision tout de suite peut aussi être une sage décision, éventuellement la meilleure à ce moment-là, indique Cathy Assenheim. Ne pas agir est parfois intelligent quand l’inhibition semble être la solution la plus adaptée. La non-action est aussi une action. » Un constat partagé par Valentine Hervé, qui précise que le non-choix, qui est encore un choix, est riche d’enseignements : « Si notre vie consiste en une suite infinie de choix, que voulons-nous éviter en ne choisissant pas ? » À nous de voir. Ou pas.
Les experts :
Cathy Assenheim, neuropsychologue, est l’autrice de J’hésite, le guide pour reprendre le contrôle (DBS, 2024).
Valentine Hervé, psychologue clinicienne et psychanalyste.
Émeric Lebreton, docteur en psychologie, est l’auteur de Faites-le maintenant ! (Marabout, 2025).
Texte : Aurore Aimelet